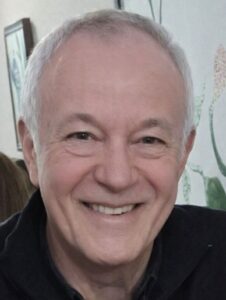
Marc TRESTINI
Membre permanent
Statut :
Professeur·e (CNU : 71)
Equipe :
Technologies et communication
Rattachement académique :
Université de Strasbourg
Courriel :
Champs de recherche :
Technologies et communication, médiation et médiatisation des savoirs, dispositif de formation entièrement ou partiellement à distance, usages et non-usages des TIC
Lieu de travail :
INSPÉ de l'académie de Strasbourg
Téléphone :
+33(0)3.88.43.82.00
Identifiant Orcid :
https://orcid.org/0000-0002-2259-2356
CV :
Thématiques
Mes travaux portent sur la médiation et la médiatisation des savoirs, autrement dit sur l’instrumentation de la communication dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage et plus particulièrement dans le cadre des systèmes de formation entièrement ou partiellement à distance. Il s’agit là de l’ensemble des processus de conception, de production et de mise en œuvre de dispositifs de communication médiatisée, incluant le choix des médias les plus adaptés à la formation et à l’enseignement ainsi qu’à leur scénarisation. Observant les limites des méthodes d’ingénierie classiques, souvent centrées sur les contenus et les apprentissages prescrits, nous analysons et proposons d’autres méthodes d’ingénierie fondées sur l’apprentissage autonome et sur la formation tout au long de la vie (FTLV). De fait, nous nous intéressons à la modélisation, la conception, l’analyse et l’appropriation d’Environnements Numériques d’Apprentissage (ENA) de nouvelle génération (OCW, MOOC, SPOC, RSN, …) qui se situent au carrefour des approches éducationnelles et communicationnelles de l’apprentissage. Ces travaux visent aussi à apporter une expertise méthodologique en ingénierie pédagogique et de formation, qui intègre le design des communautés de pratique, la gestion des connaissances et l’ingénierie des systèmes complexes reliée aux communautés virtuelles. Comme le rappelle Peraya (1999) « seule une approche interdisciplinaire permet d’appréhender, dans leur complexité, les processus de communication et de formation fondés sur les usages des TIC. Ces deux concepts se trouvent à l’articulation de plusieurs cadres de référence théoriques et de disciplines, notamment la sémiotique et les sciences de la communication, la psychologie cognitive, la technologie éducative, la théorie de l’action »
- ZEYRINGER Michael - Usages et non-usages des IA par les professeurs des écoles en France : construction d’un cadre de référence sociotechnique des usages éthiques de l’IA en éducation
- SOLON Yohan - Étude des influences mutuelles entre les outils de communication des réseaux sociaux numériques et institutionnels dans l’enseignement à distance
- MAHÉ Philippe - Systémographie d'un dispositif médiatique : le cas de la réalité virtuelle et de la créativité
- WELTIN Graziella - l'efficacité de l'approche systémique dans le domaine de la conception et de l'analyse des Environnements Numériques d'Apprentissage (ENA)
- PLATON Morgan - Participer à la gouvernance des risques : la surveillance sismique en discussion dans les projets d'extraction de lithium en Alsace
Actuellement
– Directeur du laboratoire LISEC-Unistra (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication de l’Université de Strasbourg – UR 2310), depuis 1er janvier 2026.
– Élu au Conseil national des universités (CNU 71e), depuis le 6 novembre 2023.
– Direction du Groupe Thématique numérique de la Région Grand-Est (GTnum) « IA génératives et grands modèles de langage conversationnels et/ou multimodaux », soutenu par la Direction du numérique pour l’éducation (DNE – bureau TN2 chargé du soutien à l’innovation numérique et à la recherche appliquée), du MENJS pour la période 2023-2026.
– Responsable scientifique du parcours de Master 1 &2 à distance d’« Ingénierie des Systèmes Numériques Virtuels pour l’Apprentissage » (SYNVA), depuis septembre 2018.
– Responsable scientifique de la mention Licence « Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels » et du parcours à distance de la Licence professionnelle « Développement Web, Communication et Apprentissage » (LP DWCA), depuis septembre 2018.
De septembre 2012 à janvier 2023
Président de la commission de certification du C2i2e pour l’Université de Strasbourg, de septembre 2012 à septembre 2023.
De septembre 2017 à janvier 2019
Directeur du laboratoire de recherche LISEC Alsace — UR 2310 (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication)
De janvier 2014 à janvier 2018
Directeur de l’équipe de recherche « Technologie et Communication » du LISEC.
De mars 2014 à mars 2017
Directeur du Collegium « Education et Formation » de l’Université de Strasbourg qui regroupe la Faculté des Sciences de l’Education (FSE), l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) et le Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication (LISEC).
De septembre 2010 à septembre 2014
Chargé de mission « Enseignement à distance » auprès de la Vice-Présidence « Politique du Numérique et Système d’Information » de l’Université de Strasbourg.
De septembre 2001 à janvier 2009
Chargé de mission académique TICE à l’IUFM d’Alsace et correspondant national C2I auprès de la SDT-TICE du ministère.
De septembre 2003 à septembre 2005
Responsable de l’Organisation Pédagogique (ROP) du site IUFM de Strasbourg.
De septembre 1998 à septembre 2001
Responsable Informatique du Site IUFM de Strasbourg et responsable du GTS (Groupe Technique Disciplinaire) TICE de l’IUFM d’Alsace.
De mai 1987 à septembre 1996
Responsable des cycles 3ème et 4ème technologiques des collèges et professeur principal de 3ème technologique au collège Charles Pégyuy d’Avignon.
Parcours
Professeur des universités (1ère classe) en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Strasbourg [lien] – Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de l’Académie de Strasbourg depuis septembre 2021 [lien], membre permanent du Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC – UR 2310) [lien 1] [lien 2] et membre de la chaire Unesco de Strasbourg « Pratiques médiatiques et journalistiques : entre mondialisation et diversité culturelle » [lien].
Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Strasbourg – Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) de l’Académie de Strasbourg depuis février 2008.
Récipiendaire de la Prime de Reconnaissance de l’Implication Pédagogique (PRIP) au titre de la campagne 2021.
Récipiendaire de la prime individuelle (C3) du RIPEC au 1er janvier 2025.
Récipiendaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) au titre des campagnes 2016 et 2020.
Professeur certifié des Lycées et Collèges (PLC) en Electronique et Informatique Industrielle de septembre 1991 à septembre 2008.
Doctorat en Sciences de l’Education de l’Université Louis Pasteur, soutenue le 30 novembre 2005, portant sur la « conception et l’étude d’un dispositif de formation à distance médiatisé par les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement supérieur : cas de la formation initiale des enseignants ». Conception et l’étude d’un dispositif de formation à distance médiatisé par les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement supérieur : cas de la formation initiale des enseignants Si les formations à distance ont évolué et ont su tirer profit des TIC afin de médiatiser la relation entre l’apprenant et le savoir, les dispositifs actuels ne rencontrent pas toujours, pour autant, un franc succès. Les raisons de ces réticences à l’usage de tels dispositifs sont probablement dues aux nombreux obstacles qu’il reste encore à franchir pour concevoir, mettre en œuvre et conduire ces formations. De fait, avant de généraliser leurs usages, il nous a semblé opportun de réfléchir aux obstacles qui devaient encore être levés afin que les objectifs visés aient quelque chance d’être atteints. Notre premier travail a donc été de chercher à identifier les paramètres qui joueraient en faveur ou en défaveur de ces nouvelles pratiques pédagogiques pour ensuite tenter d’imaginer et créer des conditions propices qui permettraient de dépasser ces difficultés. Ces conditions seraient essentiellement des actions à entreprendre pour améliorer l’efficacité de tels dispositifs de formation. Elles sont qualifiées d’hypothèses d’action, autrement dit « des hypothèses qui établissent un lien entre un but à obtenir et une action à mettre en place » (Berthon, 2000). Par ailleurs, nous posons comme hypothèse que ces dispositifs sont des systèmes complexes. Alors, pour que les actions à entreprendre par les concepteurs de tels dispositifs soient pertinentes et efficaces, elles doivent être induites d’une analyse de l’institution de formation selon une approche systémique. Eu égard à cette hypothèse, l’approche systémique d’Engeström qui allie habilement ces concepts en un tout organisé nous est apparue, en première approche, comme une formidable ressource permettant d’induire ces actions à entreprendre dans ce contexte particulier de la formation à distance par technologies interposées. Celles-ci ont été par la suite observées et étudiées en s’appuyant sur ce même cadre de référence qui a servi à la conception du dispositif. Notre objectif a donc été principalement de proposer une démarche pour concevoir un scénario pertinent de formation à distance médiatisée par les TIC pour ensuite étudier les effets et la validité des actions que cette démarche a suggérés.
HDR soutenue publiquement le 6 décembre 2016 portant sur la « Théorie de la complexité appliquée à la modélisation d’environnements numériques d’apprentissage de dernière génération », Université de Strasbourg.
Théorie de la complexité appliquée à la modélisation d’environnements numériques d’apprentissage de dernière génération Avec l’émergence des réseaux sociaux, des MOOC, de l’apprentissage informel via les réseaux et des approches connectivistes de l’apprentissage, l’analyse d’Environnements Numériques d’Apprentissages (ENA) devient de plus en plus complexe. Les modèles jusqu’alors utilisés pour rendre compte de l’activité instrumentée à des fins cognitives montrent aujourd’hui leurs limites. L’aspect massif d’un MOOC par exemple devient difficilement « représentable » dans ce type de modèles. Son caractère « ouvert » n’en est pas moins difficile à modéliser. De plus, l’évolution de ces environnements est chaotique et leurs effets apparaissent comme imprévisibles. Mais chaotique ne signifie pas hasardeux. Un système complexe est de nature imprévisible et il n’est pas possible de prédire directement, par le calcul, l’issue des processus en jeu. Mais il est possible, à partir d’une modélisation systémique, d’élaborer des scénarios plausibles sur la base des données disponibles (trace de l’activité, résultats de la simulation, tendances lourdes, propriétés émergentes, etc.). Comme le disait Paul Valéry, « nous ne raisonnons que sur des modèles ». Dès lors qu’il est perçu comme un phénomène complexe, un ENA de dernière génération peut donc être avantageusement représenté et analysé dans le paradigme de la Modélisation systémique de la complexité. C’est le parti-pris de cette HDR qui orientera d’ailleurs nos recherches futures
Heures de service/année universitaire
2016-2017 / 316 HTD
2017-2018 / 409 HTD
2018-2019 / 371 HTD
2019-2020 / 425 HTD
2020-2021 / 431 HTD
2021-2022 / 460 HTD
2022-2023 / 415 HTD
2023-2024 / 440 HTD
2023-2024 / 434 HTD
2024-2025 / 540 HTD
Activités d’enseignement
Depuis septembre 2021 : Professeur des universités en Sciences de l’Information et de la Communication (71e section du CNU) à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’Académie de Strasbourg (INSPÉ).
– Chargé de cours des UE 2.1c « Education aux médias et à l’information » (12 HCM et 70 HTD) et UE 4.11 « Usage des médias dans un contexte professionnel » (12 HCM/20 HTD), respectivement en M1 et M2 du Master MEEF mention « Métiers de l’Éducation et de la Formation », depuis septembre 2010.
– Chargé de cours du module C11 « Bases de la communication » (56 HTD/16 TP) et C21 « Communication avec le milieu professionnel » (40 TD) au département « Informatique » de l’IUT d’Illkirch.
– Chargé de cours des UE 31 et 32 respectivement « Systèmes complexes » (10 HCI) et « Ingénierie des EIAH pour la FTLV » (32 HCI) et de l’UE 42 « Recherche quantitative » (9 HCI) en Master 2 Synva (Ingénierie des systèmes numériques virtuels d’apprentissage » depuis septembre 2010.
– Chargé de cours (à distance) de l’UE7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4) « Interactivité numérique et apprentissage tout au long de la vie » (36 HCI) en Licence Professionnelle à distance « Développement Web, Communication et Apprentissage » (LP DWCA), depuis septembre 2018.
– Chargé de cours de l’UE 34 « Design et scénarisation pédagogique » (24 HTD) du parcours de Master 2 « Conception Formation Technologie » (CFT) de la mention « Sciences de l’éducation », depuis septembre 2009.
– Chargé de cours de l’UE 4.2 « Environnements numériques : conception et Usages » (22,5 HTD) du parcours de Master 2 « Pratiques, ingénierie et médiation sociale » (PIMS), mention « Encadrement éducatif », depuis septembre 2018.
– Chargé de l’UE 2.4 et 4.4 « Méthodes de travail universitaire (MTU) : méthodes quantitatives » (48 HTD) en L1 et L2 de la Licence « Sciences de l’Education » depuis septembre 2019.
De février 2008 à septembre 2021 : Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication (71e section du CNU) sur l’emploi 0152 « Technologies de l’Information et de la Communication, formation des enseignants des premier et second degrés » à l’Ecole Supérieur du Professorat et de l’Education de l’Académie de Strasbourg (ESPÉ) puis l’Institut National Supérieur École Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPÉ) qui intègre depuis 2018 la faculté des sciences de l’éducation, Université de Strasbourg.
– Chargé de cours des UE 1.2 « Education aux médias et à l’information » et UE 4.31 « Usage des médias dans un contexte professionnel », respectivement en M1 et M2 du Master MEEF mention « Métiers de l’Education et de la Formation », depuis septembre 2010.
– Chargé de cours de l’UE « Les enseignants et le numérique : de la maîtrise des outils au bon usage en éducation » du Parcours de Professionnalisation aux Métiers de l’Enseignement (PPME) à ESPE, de septembre 2010 à septembre 2018.
– Chargé de cours de l’UE 34 « Les outils du e-Learning» du Parcours de Master 2 « Conception Formation Technologie (CFT) de la mention « Sciences de l’éducation » depuis septembre 2009.
– Chargé de cours « Méthodes quantitatives » au département de linguistique appliquée et de la didactique des langues de la Faculté des Langues et des Cultures Étrangères de septembre 2016 à septembre 2018.
– Chargé de la préparation des étudiants de master à la certification C2i2e de septembre 2010 à septembre 2018.
– Chargé de la préparation (à distance) aux épreuves du CRPE en Sciences et Technologie au CNED, 3 allée Machado, 31051 Toulouse cedex 09, de septembre 1998 à septembre 2018.
De septembre 1996 à février 2008 : Formateur à l’IUFM de Strasbourg en détachement sur un emploi de Professeur des Lycées et Collèges.
– Chargé de la préparation à l’épreuve du concours « Sciences et Technologie » du CRPE (didactique des sciences).
– Formation professionnelle pratique des professeurs stagiaires 1er et 2nd degrés dans le domaine des Sciences et des technologies (didactique des sciences).
– Formation au C2i niveau 1 et 2 et à l’usage des TIC en éducation (TICE).
– Huit fois membre du jury de l’épreuve d’admission « oral professionnel » des PE.
– Directeur de 23 mémoires professionnels de professeurs des écoles stagiaires.
De mai 1987 à septembre 1996 : Professeur d’« Informatique industrielle » au Collège Charles Péguy comme MA2 (1987-1991) puis comme certifié (1991-1996), 27 bd Montesquieu, 84000 Avignon.
De septembre 1991 à juillet 1992 : Intervenant chargé du cours : Systèmes Informatiques au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) d’Avignon.
De septembre 1982 à octobre 1986 : Professeur de physique BAC 2000 (Lycée et BTS Informatique Privé). Résidence des facultés, av. de l’Europe, 13090 Aix en Provence.
De septembre 1982 à janvier 1985 : Professeur de Dessin Industriel au Centre de Formation d’Apprentis Forestiers (CFA), 84000 La Bastide des Jourdans.
De février 1982 à mars 1982 : Professeur d’EMT (MA3) en remplacement au collège St Joseph, 13100 Chateaurenard.
De décembre 1980 à septembre 1981 : Professeur de physique (MA3) et surveillant au Collège St Joseph, 3 bis rue des Tournelles, 94230 Cachan
Activités d’encadrement pédagogique
Depuis septembre 2018 : Encadrement du Master à distance d’« Ingénierie des SYstèmes Numériques Virtuels pour l’Apprentissage » (SYNVA) et du parcours de la Licence professionnelle à distance « Développement Web, Communication et Apprentissage » (LP DWCA), depuis septembre 2018.
Depuis septembre 2016 : Encadrement de l’UE 1.22 « Formations disciplinaires et didactiques » du Master mention MEEF « Métiers de l’Éducation et de la Formation » à l’ESPE, depuis septembre 2010. Cette UE suivie par plus de deux cents étudiants est constituée de huit matières (Sciences expérimentales, EPS, Histoire, Usages du numérique, Histoire des arts, etc.)
Depuis septembre 2009 à septembre 2018 : Encadrement de l’UE 34 « Les outils du e-Learning » de la spécialité « Conception Formation Technologie (CFT) du Master « Education, Formation, Communication » à la faculté des Sciences de l’éducation, 7 rue de l’Université, 67000 Strasbourg, de septembre 2009 à septembre 2018.
Activités dans le cadre de l’insertion professionnelle (lien avec l’entreprise)
Depuis septembre 2018 : En charge du suivi de 20 apprentis en alternance (du CFAU) depuis 2020 en tant que Tuteur Formation dans le cadre du Master Synva en lien avec le CFAU. Ce suivi comprend a minima, pour chaque apprenti, la conception et la rédaction d’un plan de formation et deux visites en entreprise (et leur compte-rendu) en compagnie de l’apprenti et du maître d’apprentissage. [lien]







